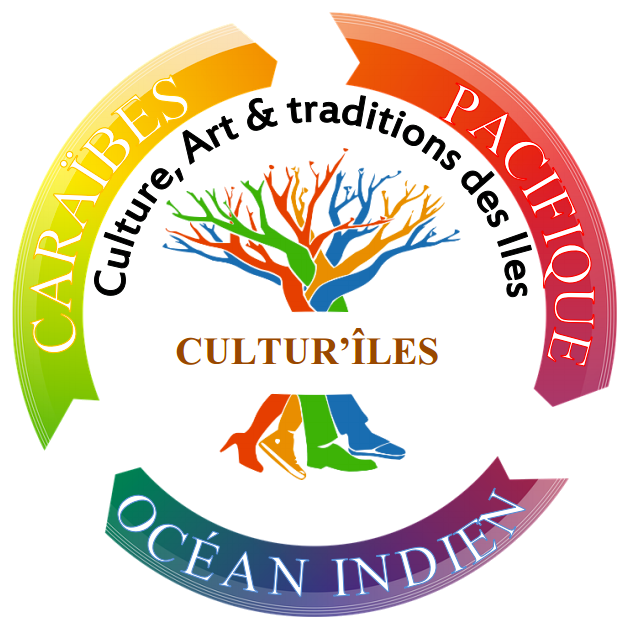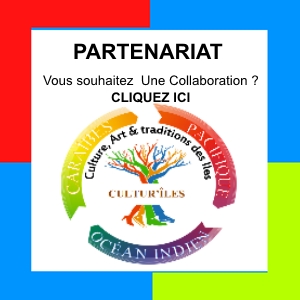Crédit: Université Mayotte
Introduction
Appelée « uvubizi » en shimaore, la pêche au djarifa est une pratique traditionnelle et ancestrale de l’île de Mayotte. Exclusivement réalisée par des groupes de femmes, cette activité perdure depuis des décennies dans presque tous les villages littoraux de l’île. Le djarifa, un filet de pêche fabriqué à partir d’éléments de récupération, permet de capturer de petits poissons ressemblant aux sardines, appelés m’hidzi ou magodra en shimaore. Cet article explore en profondeur cette pratique culturelle, son évolution, et les défis auxquels elle fait face aujourd’hui.
Historique et Origine du Djarifa
Les Premières Pratiques
Tout d’abord, la pêche au djarifa s’inscrit dans une longue tradition de pêche à pied facilitée par le marnage important de l’archipel de Mayotte. Les 230 km de côtes peu pentues de l’île constituent un terrain propice à cette activité. Pendant la période coloniale, les insulaires récupéraient les voiles des boutres pour en faire leur filet de pêche, appelé « wavu ». L’origine du nom « djarifa » reste mystérieuse, mais il désigne encore aujourd’hui un filet confectionné à partir de matériaux recyclés.
Évolution du Matériel
En premier lieu, au fil des décennies, les femmes pêcheuses ont perfectionné leurs savoir-faire et fait évoluer le matériel utilisé. Le djarifa, initialement fabriqué à partir de vieux châles en « megalini », est aujourd’hui constitué de moustiquaires cousues entre elles. Ce filet léger, relié par une corde (hamba), est devenu l’outil principal de cette pêche traditionnelle.
Le Rituel de la Pêche
Préparation et Organisation
De surcroît, lorsque la marée est basse, les femmes se dirigent vers la mer, avançant jusqu’à ce que l’eau leur arrive à la poitrine. Munies de leur djarifa, elles progressent doucement dans l’eau pour étendre leur filet au maximum. Elles tiennent le filet par les extrémités, le descendent sous l’eau et le tendent, créant ainsi une barrière.
Capture des Poissons
De plus, une fois le filet bien étendu, les autres femmes frappent l’eau pour rabattre les poissons dans le djarifa. Ensemble, elles soulèvent rapidement le filet pour capturer un maximum de poissons. Elles reviennent ensuite sur la plage pour trier leur prise, rejetant à la mer les bébés crabes, crevettes, et autres poissons non désirés. Les poissons capturés sont alors versés dans un seau ou un sac de riz vide (guni en shimaore).
Partage et Utilisation
Par ailleurs, après plusieurs répétitions de ce processus, les femmes se partagent équitablement leur récolte. Certaines utilisent les poissons pour nourrir leur famille, tandis que d’autres les vendent aux abords des routes ou dans le village, selon la quantité pêchée.
Témoignages et Souvenirs
Le Quotidien des Pêcheuses
En outre, un témoignage d’une pêcheuse révèle les défis et les joies de cette pratique : « Le plus dur de cette pêche, c’est de marcher pieds nus sur le corail et d’être coupée avec le sel, c’est très douloureux. C’est fatigant car on reste longtemps dans l’eau avec le soleil brûlant. J’aime quand même pêcher au djarifa car ainsi on perpétue la tradition et j’aime retrouver les autres femmes pour discuter, rigoler entre nous, loin de la maison. »
Une Pratique en Déclin
De surcroît, avant les années 80, cette activité était pratiquée dans la plupart des villages littoraux de l’île. Durant les grandes marées, les baies, les mangroves et les plages étaient envahies par des groupes de femmes avec leur djarifa. Cependant, aujourd’hui, on observe une diminution significative de cette pratique. D’après des témoignages de pêcheuses encore actives, « on pouvait compter jusqu’à 20 djarifa en même temps tandis qu’aujourd’hui on en observe que 1 à 4 par pêche ».
Une Activité Socio-Culturelle
Importance dans les Relations Sociales
De plus, la pêche au djarifa est bien plus qu’une simple activité économique. Elle joue un rôle crucial dans les relations sociales des communautés littorales de Mayotte. C’est un moment de convivialité, de savoir-faire et de partage entre femmes. Ce savoir-faire transgénérationnel permet de renforcer les liens sociaux et de perpétuer des traditions culturelles importantes.
Influence sur l’Alimentation
En premier lieu, la pêche au djarifa a longtemps été une activité vivrière essentielle pour les populations locales. Elle permettait d’obtenir facilement du poisson pour subvenir aux besoins alimentaires des familles, quelle que soit la saison. Aujourd’hui, bien que cette pratique soit en déclin, elle continue de jouer un rôle dans l’alimentation et l’économie locale.
Les Défis Contemporains
Évolution des Modes de Vie
De surcroît, l’évolution rapide des modes de vie à Mayotte a entraîné un déclin de nombreuses pratiques traditionnelles, y compris la pêche au djarifa. La démocratisation de l’accès à l’éducation, notamment pour les filles, a modifié les priorités et les aspirations de la jeune génération. Les jeunes filles d’aujourd’hui souhaitent également trouver leur place dans la nouvelle société mahoraise et n’ont plus le temps ou l’envie de s’adonner à ces pratiques ancestrales.
Changement des Habitudes Alimentaires
Par ailleurs, l’évolution du commerce et de l’importation a également transformé les habitudes alimentaires des Mahorais. Avec l’arrivée de nouveaux produits, tels que les « mabawa » (ailes de poulet grillées), la dépendance de Mayotte aux importations pour une grande partie de ses produits de consommation s’est accrue. Conséquemment, cela a contribué à la diminution de la pêche au djarifa.

La Pêche au Djarifa Aujourd’hui
Une Activité en Mutation
De plus, aujourd’hui, la pêche au djarifa est devenue une activité de loisir pour beaucoup de femmes à Mayotte. Les villages où cette pratique perdure fortement se situent dans les extrêmes nord et sud de l’île. Cependant, on observe une baisse d’intérêt marquée chez la jeune génération.
Préservation du Patrimoine Culturel
En outre, la pêche au djarifa reste une pratique importante du patrimoine culturel de Mayotte. Cependant, il est crucial de considérer son impact potentiel sur le patrimoine naturel de l’île. Les experts du parc marin soulignent que la capture de jeunes poissons présente un risque pour les réserves halieutiques du lagon. Cette activité écologique doit être régulée pour éviter l’épuisement des ressources marines.
Conclusion
En conclusion, la pêche au djarifa, ancrée dans les traditions séculaires de Mayotte, est bien plus qu’une simple méthode de capture de poissons. Elle représente un héritage culturel et social précieux, transmis de génération en génération. Cependant, face aux évolutions socio-économiques et culturelles, cette pratique ancestrale doit trouver un équilibre entre préservation des traditions et adaptation aux réalités contemporaines. La pérennité du djarifa dépendra de la capacité des communautés à valoriser et adapter cette tradition, tout en protégeant les ressources naturelles de l’île.