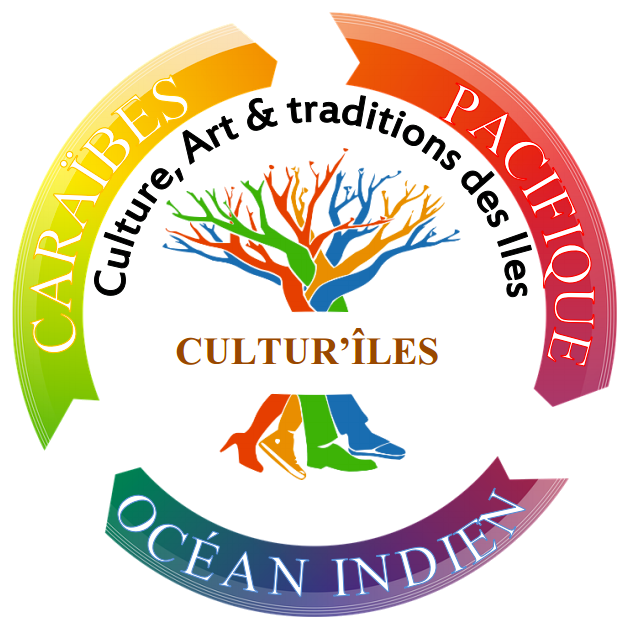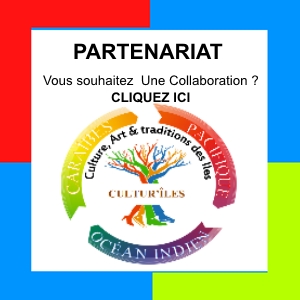Longtemps domaine des hommes, le maloya – ce chant de l’âme né des entrailles de La Réunion – connaît aujourd’hui une transformation essentielle : il s’ouvre, s’enrichit, s’illumine de voix féminines puissantes, libres, audacieuses. Christine Salem, Maya Kamaty, Ann O’aro ou encore Tine Poppy incarnent cette nouvelle génération d’artistes qui, en renouant avec les racines tout en osant l’innovation, redonnent au maloya un souffle contemporain.
À travers leurs chants, ces femmes racontent non seulement l’histoire de La Réunion, mais aussi celle des luttes féminines, des douleurs tues, des joies profondes et des espoirs futurs.
1. Le maloya : mémoire vivante d’un peuple
Le maloya est bien plus qu’un genre musical. Il est l’expression d’un peuple, d’une île, d’une mémoire collective blessée mais debout. Hérité des esclaves malgaches et africains, il fut interdit un temps, car jugé subversif. Il incarnait alors la résistance, l’affirmation d’une identité réunionnaise. Transmis de génération en génération, souvent dans la sphère familiale, il s’est perpétué dans les champs de canne, lors des cérémonies ancestrales, dans les kabars – ces veillées musicales où l’on chantait, dansait, priait ensemble.
Mais cette transmission, pendant longtemps, fut patriarcale. Les hommes portaient le tambour, scandaient les vers, prenaient la parole. Les femmes, elles, étaient présentes, mais dans l’ombre. Elles cuisinaient, dansaient, veillaient sur les enfants, chantaient à voix basse. Le maloya leur appartenait aussi, mais elles n’avaient pas toujours le droit de le revendiquer.
2. Une révolution silencieuse et résolue
À partir des années 2000, une lente mais puissante métamorphose s’opère : des femmes prennent la scène, le micro, le roulèr. Elles ne réclament pas leur place : elles la prennent, naturellement, artistiquement, avec grâce et conviction.
Parmi elles, Christine Salem ouvre la voie. Sa voix profonde, tellurique, semble jaillir des entrailles de l’île. Elle chante les ancêtres, la liberté, le mysticisme malgache, les luttes oubliées. Son maloya est à la fois enraciné et universel. Elle n’hésite pas à mêler percussions traditionnelles, influences comoriennes et harmonies contemporaines. Véritable chamane musicale, elle insuffle au maloya une spiritualité rare et l’impose sur la scène internationale.

Christine Salem @World Music Central
3. L’héritage et la modernité au cœur de la création
Autre figure majeure de cette vague féminine : Maya Kamaty. Fille du célèbre Gilbert Pounia (fondateur du groupe Ziskakan), elle aurait pu se contenter de suivre les traces de son père. Mais elle choisit de tracer son propre chemin. Son maloya est fusionnel, hybride. Elle y mêle slam, électro, poésie créole. Sa voix douce et ferme à la fois explore les contours de l’identité réunionnaise, interroge la place des femmes, défie les dogmes.
Avec elle, le maloya devient terrain de dialogues entre les âges, entre les genres, entre les cultures. Elle chante en créole, mais son message parle à toutes les générations : retrouver ses racines sans renoncer à l’invention.

Maya Kamaty @reporter+
4. Une scène plurielle et engagée
La scène réunionnaise féminine ne se limite pas à deux noms. Elle s’épanouit dans une pluralité de sensibilités. Ann O’aro, poétesse du corps et de la douleur, chante l’inceste, les abus, la résilience. Son maloya est brut, souvent a capella, empreint d’une vérité qui dérange et bouleverse. Elle fait du chant un acte politique, une délivrance, une catharsis.
Tine Poppy, quant à elle, s’illustre par un maloya solaire, engagé, ancré dans le quotidien. Elle chante les femmes, la maternité, les luttes sociales, la protection de l’environnement.
Chacune à leur manière, elles contribuent à élargir les contours de ce patrimoine musical, à l’actualiser, à le rendre poreux aux réalités contemporaines.

Tine Poppy @Sakifo 2025
5. Les thématiques féminines au cœur du maloya nouveau
Si le maloya fut longtemps chanté par des hommes, il évoquait souvent les douleurs collectives : l’esclavage, la misère, la révolte. Les femmes d’aujourd’hui y introduisent des thématiques plus personnelles, intimes, parfois taboues.
Elles parlent de maternité, de corps blessé, de sexualité, d’amour non conforme, de violences conjugales. Elles mettent en chanson des vécus longtemps tus. Cette parole, à la fois fragile et puissante, fait du maloya une musique de libération individuelle autant que collective.
Elles chantent aussi l’île, ses beautés, ses déséquilibres. L’écologie, la préservation des traditions, l’unité dans la diversité deviennent des sujets de création. Leur art devient alors vecteur d’éveil, de transmission, de transformation.
6. Une transmission vivante dans la société réunionnaise
Au-delà des scènes et des festivals, cette révolution féminine du maloya s’inscrit dans la société. Dans les quartiers, les écoles, les associations, des femmes transmettent aujourd’hui le maloya aux enfants. Elles enseignent les rythmes, les chants, la langue créole.
Dans les kabars, elles jouent du roulèr, dirigent les chœurs, mènent la danse. Elles font vivre cette tradition non plus comme un monument figé, mais comme un art du quotidien, un souffle vital.
Pour de nombreuses Réunionnaises, voir des femmes chanter le maloya, c’est se sentir reconnue, représentée. C’est retrouver dans la musique une part de soi, une mémoire maternelle, une fierté réappropriée.
7. Une scène encore en mutation
Malgré cette avancée notable, la scène musicale réunionnaise n’est pas encore totalement paritaire. Les festivals programment encore majoritairement des artistes masculins. Les femmes doivent souvent redoubler d’efforts pour se faire entendre, produire leurs disques, s’imposer dans les médias.
Mais leur présence ne fait plus débat. Elles sont là. L’avenir du maloya ne pourra plus s’écrire sans elles. Et c’est tant mieux. Car en s’ouvrant à ces voix nouvelles, il retrouve ce qu’il a toujours été : un chant de résistance, de liberté, d’émancipation.
Conclusion
Le maloya féminin n’est pas une mode, ni une parenthèse. Il est l’expression d’un changement profond, culturel, symbolique. En prenant la parole, les femmes ne dénaturent pas le maloya : elles le prolongent, le réinventent, le réenchantent.
Elles chantent La Réunion avec leurs mots, leurs douleurs, leurs rêves. Elles tissent des ponts entre hier et demain, entre le roulèr ancestral et les sonorités d’aujourd’hui. Elles sont les passeuses d’un feu ancien et nouveau à la fois.
Et dans leur voix, c’est toute une île qui résonne autrement. Plus libre. Plus juste. Plus vivante.